Le retrait des achats se fera comme d’habitude entre 11h30 et 12h30, mais dans un endroit tout à fait différent du lieu habituel, afin d’éviter un espace fermé : sur le parking du Faubourg Saint-Jean (bâtiment municipal qui jouxte le Carrefour Contact, à l’entrée de La Ferté-Milon sur la route de Villers). Mesures sanitaires obligent, les colis seront déjà prêts et emballés pour limiter au strict minium les contacts entre la clientèle et la responsable présente, Stella Haddou.
Pour les personnes n’ayant jamais eu recours à La Ruche qui dit oui, la marche à suivre est simple :
-
-
Créer un compte avec juste son adresse e-mail et un mot de passe, enregistrer, en toute sécurité, les coordonnées de sa carte bancaire
-
Sélectionner les produits souhaités : viande, légumes, pommes, laitages, œufs, riz, pâtes, miel, lentilles, huile d’olive ou de noix, viennoiseries, plats réunionnais, etc..
Le choix est très vaste, en provenance de petits producteurs, et permettra aux personnes réticentes à se rendre en supermarché de faire le plein de produits alimentaires avec un minimum de contacts.


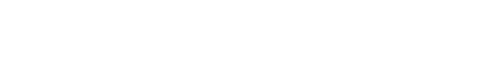
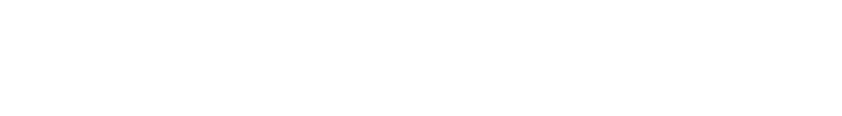

 et y accéder depuis
et y accéder depuis