Théâtre
Les compagnies du Mail au jour le jour
Publié
il y a 7 ansle
par
Denis MAHAFFEYL'art de la création théâtrale
Ce panorama de “Mail & Compagnies” a été mis à jour au fur et à mesure des spectacles, du 2 au 10 février. Les premiers se trouvent alors en bas de cet article, les derniers en haut.
Vendredi 10 février
La mort s’invite à la fête
Dans la grande salle du Mail « Calyssa en ce jour étoilé », créé quelques jours avant à Vailly, a été un des deux spectacles (avec « L’île aux pirates ») à clôturer en parallèle la semaine « Mail & Compagnies ».
La pièce, écrite par Jean-Louis Wacquiez, touche au sujet délicat de la réaction des enfants à la mort d’un proche, en mêlant, comme sait le faire cette compagnie, marionnettes et acteurs. Les deux personnages principaux, Zoë et son camarade Joachim, sont manipulés par Delphine Magdalena et Sylvain Juret, qui restent visibles et qui leur prêtent leurs voix.
La petite Zoë est fort attachée à son grand-père, ancien marin qui vit en Bretagne, et elle chérit l’objet qu’il lui envoie chaque année pour son anniversaire. Elle lui est liée encore plus dans sa riche vie imaginative. D’étranges « têtards » bien bavards lui rendent visite dans la nuit, et son grand-père y apparaît aussi.
Il n’y a pas de cadeau pour ses huit ans. Son père lui apprend que sa mère est partie au chevet du vieillard ; plus tard il lui annonce qu’il est mort.
Quelles ressources aideront Zoë à faire face à cette mort, qui mettrait autant en danger son autre vie rêvée ?
Sa famille ne fera guère l’affaire. Son père est affectueux, mais incapable de la voir telle qu’elle est – déjà il ne l’appelle que « ma chérie », comme s’il avait oublié son nom (or elle en a deux, Zoë et « Calyssa », celui qui lui est attribué dans son monde imaginaire).
C’est ce monde, dans sa propre tête, qui lui apporte secours. Un Mexicain (Jean-Louis Wacquiez) surgit de nulle part et, devant sa détresse, lui explique que même si « en France on ne parle pas de la mort » pour les Mexicains c’est une occasion de faire la fête. Il installe le cadre pour cette fête de la « muerte », avec des bougies et des objets reçus du grand-père.
Le père retrouve Zoë, Joachim et le Mexicain lancés dans une folle danse et proteste devant cette liesse inconvenable. Le Mexicain le réconcilie à la démarche. Plutôt de s’attrister devant la mort, il s’agit de célébrer toute la vie du défunt, et se réjouir que ceux qui l’aiment soient encore en vie. La mort donne de la force à la vie.
L’éloquence de ce spectacle vient des deux marionnettes, et elle leur est transmise par les deux marionnettistes. Loin d’imiter maladroitement le comportement humain, les marionnettes l’épurent, l’intensifient. Elles émeuvent en attirant l’attention sur les gestes essentiels qui montrent l’émotion.
Le comédien américain W.C. Fields est supposé avoir prévenu : « Ne travaillez jamais avec des enfants ou des animaux. » On pourrait ajouter « ou des marionnettes ». Il est difficile d’égaler leur finesse.
Jeudi 9 février
La piraterie au féminin
De l’énergie, et des masses : c’est l’ingrédient qui ne manque pas dans les spectacles Acaly pour enfants. L’histoire est menée à une vitesse trépidante, les dialogues vont au pas de course, les gestes se multiplient, la musique galope, les lumières scintillent en changeant de couleur. Surtout, les comédiens ne s’économisent pas. Et le jeune public achète chaque fois.
« L’île aux pirates » commence même sous une tempête, représentée un peu dans le style du théâtre du Soleil, par l’éclairage et des voiles qui battent au vent. Le bateau du sanguinaire capitaine Kistabiche (Didier Dordolo), le « Bouddha Volant », s’échoue en route pour l’île aux Souvenirs où un trésor attend. Son mousse Push (Cécile Migout) se trouve confronté à un dilemme : trouver une solution ou chercher un autre emploi. (Disons ici que ces deux acteurs savent occuper magistralement une scène et tenir le regard de la salle, avec une réelle candeur comique.)
Push déniche quelqu’un pour faire les réparations. Seul problème, c’est une femme, alors que le capitaine a une piètre opinion des capacités en général. Allez, une barbichette et l’illusion est parfaite. Florela (Constance Parizot) fait le nécessaire, tire l’élastique de sa barbichette – et Kistabiche doit se rendre à l’évidence de l’égalité des sexes.
Car l’autre ingrédient de tout spectacle Acaly est un message de générosité, un appel au respect du monde. Quand le metteur en scène Fabrice Decarnelle a interrogé les spectateurs après le spectacle, ils ont eu du mal à définir son sens, sans que cela veuille dire qu’à leur niveau le message ne soit pas passé.
Le bateau repart, et Fabrice Decarnelle annonce même une suite à venir au théâtre Saint-Médard en avril, dans laquelle le « Bouddha volant » arrive à la fabuleuse île aux Souvenirs.
Mardi 7 février
Le système solaire pour les tout petits
Un panneau au fond du plateau de la petit salle du Mail contient des trous ronds de différentes dimensions, placés apparemment ici et là sans raison géométrique. Une jeune femme émerge par un de ces trous. Elle saute et sautille, s’étire et s’enroule, s’assied et se lève. Surtout elle regarde et sourit aux enfants devant elle.
Elle cherche dans un grand carton une balle avec laquelle elle joue, puis une autre de taille et de couleur différentes, et une autre et une autre. Chaque balle a son caractère, et l’échange avec la jeune femme est chaque fois une conversation différente.
Sa complicité avec le public est totale. Les enfants ne la quittent pas des yeux, suivent ses mouvements, rient, réagissent à ses questions – applaudissent même le long du spectacle.
Sommée par sa mère (c’est elle-même avec un chapeau) à ranger ses jouets, elle le fait en trouvant, avec les conseils des enfants – c’est évident, elle n’y arriverait pas toute seule – le trou dont la bordure correspond à la couleur et la taille de chaque balle. Elle bouche donc les trous avec les balles l’un après l’autre. Miracle ! Le panneau apparaît comme une représentation du système solaire. C’est magique. Elle nomme les planètes, et c’est fini. Le tout a duré une demi-heure, et les enfants n’ont pas décroché.
Frédérique Bassez joue avec Musithéa pour la « Semaine » chaque année depuis 2012, quand elle a eu un petit rôle dans « Les fourberies de Scapin ». Il y a eu deux spectacles avec d’autres comédiens ; mais surtout elle a créé trois spectacles où elle est seule en scène, réagissant avec le public : « Sorcière la trouille », « Au p’tit poème » et cette année “Boules et balles”.
 Elle semble progressivement simplifier et intensifier sa démarche. Elle se comporte avec toute l’exubérance d’une fillette, mais avec une précision dans les mouvements, une souplesse de danseuse et d’acrobate. Elle se met au niveau des enfants qui la regardent, mais en ajoutant une assurance et un mordant d’adulte. Jamais elle ne laisse apparaître la moindre bonhomie condescendante, ni un enthousiasme qui cacherait des approximations.
Elle semble progressivement simplifier et intensifier sa démarche. Elle se comporte avec toute l’exubérance d’une fillette, mais avec une précision dans les mouvements, une souplesse de danseuse et d’acrobate. Elle se met au niveau des enfants qui la regardent, mais en ajoutant une assurance et un mordant d’adulte. Jamais elle ne laisse apparaître la moindre bonhomie condescendante, ni un enthousiasme qui cacherait des approximations.
Dans cette « Semaine » il y a des créations et des reprises. Pour « Balles et boules » il s’agit plutôt d’un vrai lancement après un essai. Frédérique Bassez explique : « J’ai crée ce spectacle l’année dernière, mais ne l’ai joué que pendant une semaine. » Pourquoi ? « Je ne l’ai pas assez vendu. Je sais comment créer les spectacles, pas les vendre. » De toute évidence Musithéa a su faire le nécessaire.
Lundi 6 février
Sous le plus mauvais jour
La seconde semaine de « Mail & Compagnies » a commencé par un spectacle entre création et reprise : la « re-création » par la compagnie du Milempart de « Histoires cachées ». La production date d’il y a deux ans, mais elle a été repensée, revue et remise en scène, et la distribution a changé.
Sans atteindre la pureté acrobatique et abstraite de « Contes de des contes » de la « Semaine » 2016, la production est rapide, nerveuse, les mouvements sont souvent chorégraphiés ou au moins formalisés. Mélanie Izydorczak et Laurent Colin, fidèles du Milempart, Emilie Letoffé, et un nouveau comédien Thibaut Thibaux deviennent tour à tour personnages ou commentateurs, émergent l’un après l’autre d’un vieux coffre avec une tricherie maligne, ou disparaissent dans un placard aux airs de cabine de magicien. Ils se présentent hommes ou femmes selon les besoins de l’intrigue.
Didier Viéville, metteur en scène de la compagnie, a adapté trois contes de Maupassant en prenant des libertés nécessaires pour le passage de nouvelle en théâtre. « La relique » est un conte épistolaire transformé en pièce. Un fiancé qui traite la vérité comme une pâte à modeler s’y englue en essayant de faire passer un vulgaire os d’animal pour une relique de saint. Sa fiancée exige une vraie relique ; il serait prêt à aller jusqu’à Rome, mais craint que même le Saint Père ne puisse l’aider.
« Le parapluie » offre une occasion de cumuler l’avarice, la malhonnêteté et l’humiliation autour d’un parapluie usé jusqu’aux baleines, et d’un autre dont le vil prix explique sa rapide détérioration.
Pour « Le petit fût », la « Mère Magloire » du conte devient le « Père », qui tombe aussi facilement dans le piège qui consiste à l’amener à donner sa maison en viager, puis à l’arroser de « fine » en libre service et jusqu’à l’apoplexie.
Par coïncidence le théâtre amateur du Grenier a choisi le même conte parmi d’autres pour son spectacle « Histoires vraies ». Colette Fourreaux y campe une magistrale soularde dans le rôle de la « Mère ». Didier Colin titube de façon aussi convaincante.
Le public pour ce spectacle dans la grande salle est fait surtout de classes de Quatrième. « C’est parce que Maupassant est à leur programme » explique Didier Viéville, qui regrette cette limitation. Ce n’est pas qu’en Quatrième que les jeunes peuvent s’amuser – et s’instruire – devant le spectacle des faiblesses humaines.
« Histoires cachées » excelle à pointer les dilemmes dans lesquels Maupassant place ses personnages, qui se fourvoient en cédant à leurs instincts les moins élevés. D’éventuelles victoires sont toujours viciées par les moyens adoptés pour les atteindre. La production a la bonne idée, par sa mise en scène, d’éviter une représentation naturaliste de l’abjection. L’humain est vu sous son plus mauvais jour, la marque de Maupassant, mais la présentation stylisée met la distance qu’il faut.
Vendredi 3 février
Une journée gastronomique et fabuleuse
La compagnie Les Muses s’y Collent n’a pas de problème à créer un spectacle chaque année pour la « Semaine de la création théâtrale » Après les cartons vides de « Tangram » en 2016, Karine Tassan et Rémi Gadret reviennent avec une cuisine modulable pour une nouvelle recette théâtrale. « La cuisine de Zélie » montre les préparatifs d’un dîner pour « Monsieur Gourmand ». La cuisinière suit les recettes pour une « soupe aux bulles », un « soufflé sifflant » et un « gâteau à comptines ». Ce menu traduit une loufoquerie gastronomique constante, où chaque geste est traduit par son commis musicien en sons, de percussion ou autres.
La musique et la sonorisation du spectacle sont élaborées et éloquentes. Après une introduction tirée, selon Rémi Gadret, de la partition écrite par Bernard Herrmann pour « Citizen Kane », tout consiste en sons générés sur divers instruments et objets. L’idée la plus spectaculaire est une contrebasse improvisée à partir d’une poubelle retournée, une ficelle et une manche à balai. Non seulement elle marche, mais un système de looping permet à la musique de se poursuivre encore après le démontage.
C’était la « deuxième » du spectacle, créé la veille. Karine et Rémi admettent avoir besoin encore de le rôder, de synchroniser les sons et mouvements. Sous ses apparences ludiques, la pièce est complexe, et demande un jeu bien synchronisé.
Beaucoup de spectateurs dans la salle étaient assez jeunes pour réagir, non pas avec un regard critique posé et pesé, mais avec des sensations. Felix, trois ans, de l’école de Chacrise, par exemple, ne voudrait plus voir cette pièce « parce que je n’aime pas la soupe au crapaud ». En effet, après avoir collecté des bulles émises par des poissons pour sa soupe, à laquelle elle ajoute du savon râpé, la cuisinière sort un pot rempli d’une matière verte, visqueuse et, elle l’avoue elle-même, puante, dont elle ajoute un bloc gluant à la marmite ; la recette n’exigeait-elle pas « de la bave de crapaud » ? Voilà le pouvoir du théâtre, convaincre sans avoir besoin d’être crû.
Pass’ à l’Acte, qui tient aussi à présenter chaque fois une création, a joué la suite de « La Fontaine à fables » de l’année dernière, sous le titre logique de « La suite à fables ». Le principe, une relecture de certaines fables de La Fontaine par Eric Tinot et Fabrice Ply, mise en scène par Mario Gonzalez, est maintenu, et le décor, un grand panneau couvert de 1 800 fleurs de dentelle blanche, revient aussi.
Les acteurs masqués ou des marionnettes jouent au dessus de ce panneau, qui sert d’écran de projection. Pour certaines histoires, telle « Le chat et le renard », les marionnettes émergent par des fentes dans ce panneau. Un poisson y nage, une fourmi passe la tête.
Le texte de La Fontaine est parfois respecté, parfois adapté. Le traitement peut être mis à jour aussi. Au lieu de s’enfler, la grenouille qui veut être aussi grosse qu’un bœuf fréquente des salles de musculation, augmentant son tour de poitrine comme son tour des biceps, mais le résultat est pareil : crevaison spontanée.
Le spectacle déploie une grande énergie bien ciblée, et une complicité est construite avec le public, souvent invité à répondre et à commenter. Le public pour cette séance matinale était très jeune ; la veille les acteurs et metteur en scène avaient répondu longuement aux questions de spectateurs plus âgés.
denis.mahaffey@levase.fr
Jeudi 2 février – 1er jour
Une création et une reprise
“Mail et Compagnies”, la semaine de la création théâtrale, a commencé par une création et une reprise.

Entre Mario Gonzalez (à dr.) et Fabrice Ply, Eric Tinot répond aux questions des jeunes spectateurs après le spectacle.
Dans la petite salle en bas, la compagnie Pass’ à l’Acte a dévoilé la suite de « La fontaine à fables » de l’année dernière : “La suite à fables”. Mario Gonzalez a mis en scène ce spectacle de marionnettes manipulées par Eric Tinot et Fabrice Ply. Il en sera dit davantage après la séance de vendredi matin.
Dans la grande salle – trop grande pour l’échelle du spectacle – Arts et nuits blanches a repris, à la demande des organisateurs, « Eléonore et l’ancêtre » de Gérard Blaud. La pièce garde toute sa pertinence dans ces années du centenaire de la Grande guerre.
Une jeune fille retrouve un soldat dans son grenier. D’où surgit-il ? D’où vient son uniforme bleu horizon ? Comment expliquer son ignorance de tout ce qui fait le monde moderne ?
L’incompréhension est totale entre lui et la fille, comme s’ils ne parlaient pas le même langage. Il s’avère que c’est l’arrière-grand-père d’Eléonore, revenu à la vie on ne saura pas comment. Les générations apprennent difficilement à se connaître, à se comprendre, à approfondir leur relations, alors que l’ancêtre raconte sa vie avant et pendant la guerre à son arrière petite-fille.
Ghislaine Ferrer et Sébastien Lalu ont affiné leur jeu depuis la création. Eléonore en particulier s’est intériorisée, et les relations initiales entre elle et le soldat sont moins un affrontement qu’un questionnement de chaque côté. Quand le soldat repart dans l’inconnu, un regret palpable flotte dans l’air.
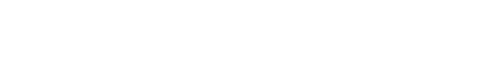









 et y accéder depuis
et y accéder depuis