Les opposants envisagent un recours
Une deuxième réunion des opposants à la localisation du projet d’unité de méthanisation s’est déroulée à La Ferté-Milon, opposants regroupés pour un certain nombre dans l’association Mieux Vivre à La Ferté-Milon (MVFM).
Les porteurs du projet, Michel Gille (directeur de l’endiverie) et Charles Bellet (directeur de la coopérative), étaient présents afin de faire entendre leurs contre-arguments.
La secrétaire de MVFM se remémore : « Notre collectif a vu le jour après la réunion d’information à l’endiverie en octobre 2018, réunion qui nous a alertés plus que rassurés sur les problèmes qu’allaient rencontrer les riverains. » De plus, le fait qu’il n’y ait eu ni concertation en amont avec les Milonais (avant ou après le dépôt de la demande du permis de construire, en mars 2018) ni étude d’impact, en particulier sur le devenir dans dix ou vingt ans, a vraisemblablement créé un sentiment de malaise.
Un intervenant déplore : « On est dans l’incertitude, on nous dit différentes choses sur les risques, les odeurs incommodantes, le trafic des camions. » Les anti-projets affirment que le risque d’odeurs au quotidien est tout à fait possible et que, si les racines d’endives n’auront certes plus à sortir du site (NDLR : elles iront dans le méthaniseur sur place), le transport des citernes de digestat vers les zones d’épandage devrait occasionner le passage de douze camions de 44 tonnes par jour en plus.
Un autre intervenant met rapidement les pieds dans le plat : « Le risque d’explosion est minime, mais il est là. » En effet, de 1992 à 2017, 18 cas d’incendie et 15 cas d’explosion ont été recensés en France par le ministère de l’Environnement, c’est-à-dire à une époque où la méthanisation était encore réduite. Fin 2010, il existait une centaine de lieux, mais désormais beaucoup plus. Et selon MVFM, « si l’on se fie aux articles parus dans la presse, les cas ont été bien plus nombreux ». De plus, le ministère ne recense pas les accidents.
La proximité en question
L’une des craintes des Milonais présents est la proximité (moins de 50 mètres) du futur méthaniseur avec le seul point de captage d’eau potable à La Ferté-Milon. Un intervenant s’insurge sur le fait que « le captage est fragile, ce n’est pas seulement une question de distance ; s’il y a la moindre explosion, la voûte du captage s’effondrera et l’on sera tous à l’eau minérale pendant un an ». Néanmoins, la loi autorise la construction d’un méthaniseur s’il est à plus de 20 mètres d’un point d’eau potable.
Autres sujets très sensibles pour certains membres de l’assistance : « Les habitations les plus proches qui risquent de perdre de leur valeur ou même être invendables » ; « la proximité de l’école primaire à 500 mètres et du lycée technique, avec le risque que des parents ne viennent pas s’installer à La Ferté-Milon, d’où perte d’élèves potentiels » ; « le possible amalgame dans un récent bulletin municipal au sujet des emplois qui pourraient être menacés à l’endiverie si les opposants obtenaient gain de cause ». Le point d’orgue de la réunion est le témoignage de Patrick Bisbrouck, qui habite à 200 mètres du site de méthanisation d’Ussy-Sur-Marne : « Avec un problème de vent dominant, la méthanisation, ça sent mauvais quand on en est proche, à cause de la torchère et du soufre à l’intérieur de la cuve. J’ai même eu de mauvaises odeurs à seulement 3 degrés. Et une question que vous devez vous poser, c’est comment sera tenu le site : sur celui près de chez moi, il y a des écoulements d’eau mal gérés, ça sent mauvais. Je subis aussi le passage des camions, la poussière et la dérive qui a eu lieu, à savoir l’introduction du lisier comme intrant, ce qui n’était pas prévu ; cette dérive-là, personne à La Ferté-Milon ne l’intègre au projet au jour d’aujourd’hui. »


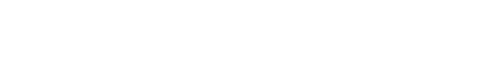

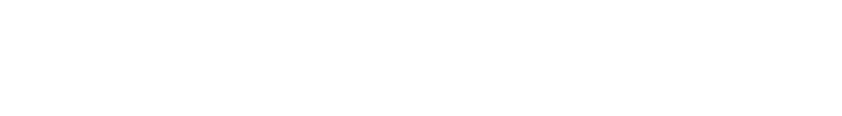

 et y accéder depuis
et y accéder depuis