

Actualités
Rockwool : le bilan de la concertation
Les dirigeant de Rockwool sont allés à la rencontre de la population pour expliquer leur projet et échanger avec les habitants. 300 personnes ont pris part aux cinq réunions publiques.
Publié
il y a 5 ansle
Le groupe Rockwool, producteur de laine de roche pour l’isolation, prendra sa décision définitive de construire une usine de fabrication sur la zone du Plateau Ploisy-Courmelles à l’été 2019. Toutes les études détaillées et les demandes d’autorisations seront alors déposées avant enquête publique début 2020. L’heure n’est en effet qu’aux études de faisabilité, mais le groupe a pris l’initiative de proposer une concertation préalable de cinq réunions publiques, conduites par un garant neutre de la commission nationale du débat public. « Cette concertation volontaire a pour but d’informer la population sur le projet et de répondre à toutes les questions, explique Maurice Laboue, le directeur du projet soissonnais de Rockwool. Mais aussi de recueillir les avis et d’entendre les suggestions pour enrichir le projet, puis nous le ferons évoluer en fonction de ces échanges avant de poursuivre les études. »

LE PROJET
Rockwool est un groupe d’origine danoise fondé en 1937, leader mondial de la laine de roche. Il représente 11 000 salariés sur 45 usines dans 39 pays. Il fabrique des panneaux isolants à partir de roches éruptives, de minéraux, de matières premières et secondaires.
Une filiale française a été créée en 1978 à Saint-Eloy-les-Mines en Auvergne. La genèse du projet soissonnais est née avec la volonté de Rockwool de créer une nouvelle usine en France. D’un côté, les développements successifs de l’usine de Saint-Eloy-les-Mines ne permettent plus d’augmenter sa capacité de production. De l’autre, le groupe voit des perspectives de développement sur le marché français et en région parisienne plus particulièrement, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
De fait, les dirigeants de Rockwool se sont positionnés sur une possible implantation dans le Soissonnais pour plusieurs raisons : « La proximité des marchés pour limiter les distances de transport ; le terrain prédisposé à recevoir un équipement industriel sur la ZAC du Plateau ; un grand espace disponible de 39 hectares permettant d’envisager de futurs développements ; une desserte routière de qualité avec la RN2 ; l’accueil favorable des collectivités. »
L’usine serait organisée ainsi : un site de réception et de stockage des matières premières ; des bâtiments dédiés à la production de laine de roche avec un four fonctionnant à l’électrique ; un espace logistique pour l’expédition des produits finis ; un bâtiment dédié aux services administratifs et aux salariés.

Selon les caractéristiques de l’usine, le groupe prévoit de produire 110 000 tonnes de laine de roche par an, correspondant à l’isolation complète d’environ 80 000 maisons individuelles. L’usine sera construite avec trois cheminées dont la principale est à l’étude pour ne pas dépasser 50 mètres, et ainsi conserver l’aérodrome de Soissons – Courmelles sur son actuel terrain. Elle génèrera un trafic d’environ 100 camions par jour sur la zone du Plateau (200 allers -retours) sauf le week-end. A savoir que le trafic actuel sur la RN2 est supérieur à 19 000 véhicules par jour en semaine. Il est également annoncé 130 à 150 emplois directs et 300 à 400 emplois indirects.
L’emploi et les retombées économiques
Le groupe Rockwool annonce que son projet sera créateur d’emplois. Pendant la construction de l’usine d’une part, avec 80 personnes mobilisées en moyenne pendant 18 mois, et des pics à 300 personnes. Et surtout en phase d’activité, avec 130 à 150 emplois directs créés. Ces emplois concernent des personnes diplômées du CAP au BAC + 5 pour des postes de caristes, ouvriers qualifiés, responsables de ligne, personnel administratif et ingénieurs. Rockwool affiche une volonté de recruter localement et prend exemple sur son usine de Saint-Eloy-les-Mines dont 90 % des employés habitent à moins de 30 km.
Le groupe reproduira également la même politique salariale, selon la convention collective « carrières et matériaux » : 97 % des salariés ont un contrat CDI ; primes de postes, 13e mois, primes vacances, primes d’ancienneté ; une participation versée chaque année et qui peut représenter jusqu’à deux mois de salaire…

En terme de développement économique, Rockwool voit un projet vecteur de 300 à 400 emplois indirects. Il seront mobilisés dans plusieurs secteurs :
- Logistique (pour les matières premières et les produits finis) : de 6 à 7 millions d’euros par an en travaillant avec plusieurs transporteurs régionaux.
- Gardiennage, nettoyage, blanchisserie et entretien des espaces verts.
- Achat de matières premières locales : palettes en bois, films plastiques, dolomie, laitier de fonderie…
- Maintenance : de 3 à 4 millions d’euros par an de dépenses externes estimées.
D’autres retombées sur le territoire sont évoquées : l’hébergement (surtout pendant la phase de construction), la restauration, les transports publics, la mobilisation des centres de formation ou le développement commercial.
Les déchets
Rockwool atteste une production très réduite de déchets. Patrice Foury, le responsable sécurité, environnement, qualité et développement durable précise que « les déchets de laine de roche représentent la majorité des déchets, et ils seront recyclés à 100 % dans le four électrique. Les autres déchets sont les plastiques et les palettes qui seront recyclés ou valorisés, et les activités de maintenance, traitées en filière adaptée. De plus, la ferraille obtenue au cours de la fusion est revendue à des aciéries. »
L’eau
La consommation d’eau pour le projet soissonnais est évaluée à 10 m3/ h maximum, soit 80 000 m3/ an, ce qui représente la consommation d’eau annuelle de 700 ménages. Elle est utilisée pour la dilution du liant, le refroidissement et le lavage des équipements.
L’eau proviendra de la récupération des eaux de pluie (entre 5 et 30 % selon la pluviométrie) et du réseau d’alimentation en eau potable, mais aucune station de pompage n’est prévue. En revanche, un traitement et une réutilisation en interne des eaux industrielles sont programmées. Les rejets dans le réseau des eaux usées proviendront des sanitaires et du traitement pour l’adoucissement de l’eau.
Les rejets atmosphériques
L’usine Rockwool sur la ZAC du Plateau fonctionnera avec un four électrique. Pour Patrice Foury, le responsable sécurité – environnement : « Ce processus de fusion divise par 7 la quantité de CO2 par rapport à un four fonctionnant au coke (NDLR : à charbon). Nous mettrons de plus en œuvre les meilleurs techniques disponibles en terme de filtres, brûleurs et abattement. »
A la sortie des cheminées d’une usine de laine de roche, on retrouve ces rejets : dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, poussières, ammoniac, phénol, formaldéhyde et COV (composés organiques volatils).
A l’occasion des réunions de concertation préalable, les dirigeants du groupe ont présenté les mesures des rejets de l’usine de Saint-Eloy-les-Mines en comparaison avec les valeurs limites. A savoir toutefois que Saint-Eloy ne présente pas du tout les mêmes caractéristiques que le projet soissonnais puisque l’usine auvergnate est située dans une cuvette en cœur de ville, elle fonctionne avec trois lignes de production dont deux fours à coke et produit 240 000 tonnes de laine de roche. Pour rappel, l’usine soissonnaise se situeraient en hauteur sur le plateau de Ploisy-Courmelles, elle fonctionnerait avec une seule ligne de production électrique pour produire 110 000 tonnes de laine de roche.
En 2018, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (la fédération des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air en France) a étudié la qualité de l’air à Saint-Eloy-les-Mines et a publié ses conclusions.

Dioxyde d’azote : « Les niveaux de dioxyde d’azote, polluant essentiellement lié à la circulation automobile, peuvent être considérés comme faibles. »
Particules fines (PM10) : « Les relevés de particules en suspension PM10 sont conformes à ceux habituellement enregistrés dans la région, avec une réelle homogénéité spatiale. »
Dioxyde de soufre : « Les niveaux de dioxydes de soufre sont très faibles, les plus faibles enregistrés depuis la mise en place des campagnes de suivi sur la commune. »
Phénol, formaldéhyde et ammoniac : « les niveaux sont homogènes et ne révèlent aucun impact réellement quantifiable en provenance de l’usine. […] Les valeurs sont très en deçà des seuils préconisés par les organismes de référence […] »
De fait, les dirigeants de Rockwool se targuent d’avoir « un impact très faible sur la qualité de l’air à Saint-Eloy-les-Mines » et voient à Soissons des rejets moindres du fait de l’utilisation de l’électrique et non de l’énergie fossile et d’une production dans tous les cas bien inférieure. Ils précisent cependant que les concentrations et les volumes de rejets sur le projet soissonnais seront déterminés précisément dans l’étude d’impact à venir, réalisée en vue de l’enquête publique.
La gestion des nuisances
Tout au long des réunions publiques, Matthieu Biens, le directeur marketing et développement de Rockwool, et le directeur du projet Maurice Laboue ont rappelé qu’avant l’implantation de l’usine, le groupe doit nécessairement suivre un processus d’autorisation qui passe par la réalisation d’un dossier d’étude d’impact dans plusieurs domaines (eau, rejets, faune/flore, trafic, bruit, luminosité, odeurs, santé…), un dossier d’étude de dangers, puis l’instruction du dossier par les services de l’Etat et l’Agence Régional Santé, suivie de l’enquête publique et enfin la délivrance d’un arrêté préfectoral avec ses exigences environnementales.
Le bruit
Les sources de bruit de l’usine seront liées au procédé de fabrication (turbines, extracteurs…) et aux convoyeurs ; aux flux logistiques des camions et chariots élévateurs. Par rapport à sa situation sur la ZAC du Plateau, Rockwool précise que « les habitations les plus proches sont à 800 mètres et que la zone bénéficie d’un écran de verdure permettant d’atténuer la propagation du bruit ». De plus, le groupe entend utiliser ses produits « pour renforcer les protections sonores, des silencieux sur les équipements les plus bruyants et des équipements conçus pour cantonner les sources de bruit à l’intérieur des bâtiments. » En ce qui concerne les flux logistiques, les horaires de livraisons, de chargements et d’expéditions se feront en journée et en semaine.
Les poussières / lumières / odeurs
Selon Rockwool : « Toutes les origines possibles de poussières sont captées et/ou filtrées ». Les sources de poussières sur le site – hors rejets des cheminées – proviennent des matières premières (roches) et des produits finis (fibres), sachant que les stations de déchargement des matières premières seront couvertes.
Pour ce qui est de la pollution lumineuse, le groupe annonce que « l’activité principale est concentrée à l’intérieur des bâtiments quand l’éclairage extérieur est limité à l’éclairage de sécurité et la mise en stock des produits. Des mesures de réductions seront tout de même envisagées avec un éclairage dirigé vers le sol, l’extinction automatique et l’éclairage LED ».
A propos des odeurs, les dirigeants assurent : « Autour des sites Rockwool, aucune odeur n’est perceptible. Les sources d’odeurs potentielles pourraient provenir du four à coke mais ce ne sera pas la cas ici du fait de l’utilisation de l’électrique. »
L’électricité
L’usine aura un besoin électrique de 30 MW au maximum, dont 20 MW pour le four électrique. Un raccordement sera donc nécessaire au réseau à haute tension exploité par RTE. Une procédure de raccordement est en cours. A ce stade, il est envisagé de réaliser une liaison souterraine directe entre le poste RTE de Soissons-Notre-Dame et le poste électrique Rockwool à créer dans la parcelle. Les câbles seront enterrés à 1,50 m de profondeur et invisibles après travaux.
Le paysage

Dans son projet sur la ZAC du Plateau, Rockwool prévoit le bâtiment de fusion électrique à une hauteur de 30 m environ avec d’autres bâtiments à une hauteur maximum de 15 m. Pour les trois cheminées : le groupe travaille pour que la cheminée « fibrage » ne dépasse pas les 48/50 m avec un diamètre d’environ 3,5 m. La cheminée « fusion » : 35 à 40 m avec un diamètre inférieur à 1 m. La cheminée « cuisson / refroidissement » : environ 30 m et un diamètre de près de 2 m. En sortie de cheminée, un panache sera visible sur la cheminée « fibrage » selon les conditions météorologiques.
Pour favoriser l’intégration de l’usine dans le paysage, le groupe a envisagé des mesures : « Un travail architectural à mener dans le cadre de la réalisation des dossiers de demande d’autorisation environnementale et de permis de construire ; une intégration paysagère des cheminées qui doit tenir compte des impératifs de sécurité aérienne ; la volonté de mettre en œuvre des aménagements paysagers complémentaires. »
Les questions de la population à Rockwool
A l’occasion de la réunion de clôture du 5 février, le garant de la concertation préalable, François Desmazière, a établi que 300 personnes au total ont participé aux cinq réunions successives à Courmelles, Belleu, Soissons, Chaudun et Cuffies. Durant les échanges au cours desquels le public a pu s’exprimer et poser ses questions sur le projet, le garant a comptabilisé 130 interventions. A celles-ci s’ajoutent trois contributions : celles du collectif de riverains de Berzy-le-Sec, Chaudun, Courmelles, Missy-aux-Bois, Soissons et Vauxbuin, du collectif de riverains de Dommiers et du Réseau de transport d’électricité (RTE). Il est à noter que seulement 405 visiteurs sont allés sur le site internet de la concertation préalable ouvert depuis le 18 décembre. François Desmazière n’y a reçu que 5 questions et 4 avis.

La concertation a bien sûr eu le mérite de débattre sur plusieurs points et préoccupations. En voici les principales interventions :
L’usine sera-t-elle classée Seveso ?
Maurice Laboue (directeur du projet) : « L’usine ne sera pas classée Seveso car elle ne fabriquera pas son liant, au contraire du site de Saint-Éloy-les-Mines. »
La toxicité du liant est-elle importante et quelles sont les conditions de sécurité nécessaires au stockage ?
Maurice Laboue : « Le liant sera stocké en silos, avec des bassins de rétention qui renforceront la sécurité. Concernant le liant, sa base est le formol, produit qui nécessite effectivement quelques précautions. Toutefois, les risques principaux d’exposition de la population vis-à-vis du formol sont à l’intérieur de chaque habitation. »
Les rejets vont-ils se rendre dans la vallée et densifier le brouillard ?
Bernard Combel, membre des Ailes Soissonnaises : « Lorsqu’une perturbation cyclonique arrive de l’ouest, en provenance de l’Atlantique, elle fait monter les fumées. En cas d’anticyclone, elles vont se rabattre vers le sol. Or, en cas d’anticyclone, les vents sont en provenance du nord-est ou de l’est et se dirigent vers l’ouest, ce qui éloignera les fumées de Soissons. Dans les deux cas de figure donc, il n’y aura pas de conséquences. »
Quelles sont les conséquences de l’ammoniac et du phénol sur les cultures comme le blé ou le colza ?
Patrice Foury, responsable environnement : « Dans le cas du phénol, l’impact au sol et dans l’atmosphère est si faible qu’il n’est pas mesurable. Concernant l’ammoniac, la dispersion est forte et l’ammoniac est un élément déjà présent dans l’atmosphère puisqu’il est généré par la décomposition des matériaux végétaux, les digestions animales, les engrais, les activités organiques. L’impact précis de l’usine Rockwool sera évalué au cours des études à venir. »
La température des rejets issus de la cheminée est-elle élevée ?
Maurice Laboue : « L’air rejeté est globalement chaud, environ 50 degrés, et humide. La visibilité de la fumée est tributaire de la température extérieure : si l’air est frais, la fumée est visible ; à température moyenne, elle n’est quasiment pas visible. »
Quel serait l’impact de l’usine en projet sur les cultures bio aux alentours ?
Jean-Marie Carré, président de GrandSoissons Agglomération : « J’ai fait des recherches et de nombreuses productions bio sont en activité dans la région de Saint-Éloy-les-Mines. Aucun frein à leur activité n’a été engendré par l’usine Rockwool. »
Dans le cas d’une cheminée à 50 mètres inférieure à Saint-Eloy-les-Mines, l’aérodrome ne risque-t-il pas d’être déplacé et la hauteur de la cheminée augmentée sur le long terme ?
Maurice Laboue : « A Saint-Éloy-les-Mines, la cheminée est d’une hauteur de 85 mètres car l’usine est implantée en pleine ville. Dans le Soissonnais, la contrainte vis-à-vis de l’aérodrome est de ne pas dépasser 202 mètres d’altitudes : la cheminée ne doit pas donc pas aller au-delà de 47,5 mètres pour permettre une cohabitation. Compte-tenu de la configuration du site, des vents, et des études sur l’air chaud qui a été menée, le premier modèle de dispersion est satisfaisant. La décision sur la cohabitation avec l’aérodrome revient à la Direction Générale de l’Aviation Civile. »
Quel sera le coût du raccordement électrique et qui va payer ?
Aurélien Lespinasse (RTE) : Le coût n’a pas encore été arrêté mais il sera assumé par le client, à savoir Rockwool.
D’où viennent les matières premières ?
Maurice Laboue : « Pour l’heure, ce paramètre n’a pas encore été fixé. A priori, la roche volcanique proviendra de l’Est de la France, des Vosges ou des Ardennes. Le laitier proviendra probablement du nord de la France. Si de la dolomie est utilisée, des sites se trouvent dans le bassin parisien. Concernant la bauxite, utilisée en très petite quantité, Rockwool s’approvisionnera surement en Sardaigne ou en Grèce. »
Est-il envisagé d’utiliser des transports du Soissonnais ?
Maurice Laboue : « Dans la mesure du possible, Rockwool fera appel à des transporteurs locaux qui sont plus pertinents à effectuer cette mission. »
Quelles sont les ambitions de développement de Rockwool ?
Maurice Laboue : « Une deuxième ligne de production n’est pas prévue par Rockwool. Toutefois, le développement sur la parcelle peut s’orienter vers un atelier de transformation visant à fabriquer des produits dérivés. »
Le calendrier prévisionnel
Le directeur du projet Maurice Laboue a annoncé que Rockwool prendra sa décision finale pour s’implanter sur la ZAC du Plateau au milieu de cette année 2019. L’enquête publique se déroulera durant les 1er et 2nd trimestres 2020. Puis en fonction des autorisations préfectorales, les travaux de construction de l’usine pourraient débuter dès la mi-2020 pendant 1 an et demi, avec l’objectif de démarrer la production au début de l’année 2022.
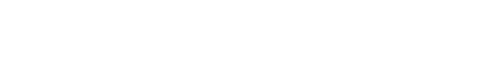
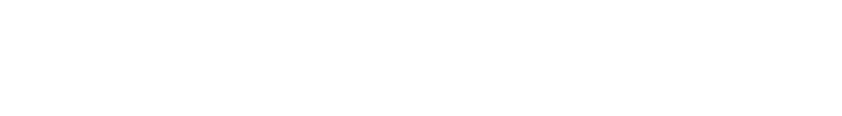

 et y accéder depuis
et y accéder depuis