Théâtre
VO jour le jour 2018
Publié
il y a 6 ansle
par
Denis MAHAFFEYL'art du festival
Un spectacle a lieu en temps réel ; la réflexion qui permet d’en rendre compte se mesure en temps écrit, notion difficile à préciser. Le navire de VO en Soissonnais 2018 a disparu du quai et même de l’horizon, cette chronique à terre revient encore sur ses qualités. Voici les dernières critiques.
Le choix des spectacles a été heureux : jamais une production vite faite, routinière, suivant une recette trop connue. Les voir l’un après l’autre a été remuant, excitant, émouvant, hilarant. Le théâtre des petites formes est vigoureux, et la longue expérience des prospecteurs VO les aide à savoir où il faut creuser pour trouver de l’or.
Les salles n’ont pas toujours été pleines et les sièges vides laissent la place à un petit vent froid. Espérons que nous pourrons encore nous réchauffer ensemble l’année prochaine._________________________________________________________________________________
Bruxelles / Brüssel
La qualité qui a fait de Poupette in Bruxelles un choix retentissant pour clore VO en Soissonnais 2018 est sa transparence. Dans ce « spectacle de marionnettes, musical et vidéo », comme il est défini dans le programme, tous les moyens, de la manipulation de marionnettes à la musique, des séquences vidéo aux ombres chinoises, du déplacement d’éléments de la scénographie aux effets spéciaux artisanaux, sont déployés et employés en pleine vue des spectateurs. Rien n’est caché : les marionnettistes restent visibles, une vidéo d’un bus se précipitant dans les rues de Bruxelles vient d’une série de maquettes montées sur une bande en boucle actionnée par une grande poignée d’essoreuse sur scène.
Loin de réduire l’impact, cette transparence l’intensifie, en attirant l’attention sur la coordination minutieuse des acteurs. Ils sont toujours là où il le faut, dans une chorégraphie complexe. La coordination de chaque mouvement, chaque geste donne du brillant à l’histoire.
Poupette in Bruxelles est adaptée du roman Deesje de l’auteure néerlandaise Joke van Leeuwen, mais l’action est transposée à la ville de la diversité culturelle et linguistique qu’est Bruxelles. Un père envoie sa jeune fille seule dans un train à la ville pour rester chez sa mère, dont le nouveau compagnon la cherchera à la gare. Mais ce néerlandophone comprend mal les consignes en français du père au téléphone. La fillette se trouve toute seule dans la grande ville, où elle a beaucoup d’aventures et fait face à beaucoup de dangers avant d’être retrouvée par son beau-père.
Ils sont deux Flamands et trois Wallons – twee Vlamingen en drie Walen – sur le plateau. Ces Belges se sont identifiés eux-mêmes en tant que francophones ou néerlandophones dans la « rue » de la CMD après le spectacle. Cela a du sens pour un pays aussi divisé par la langue et la culture que la Belgique : deux compagnies, Froe Froe de la région flamande et Théâtre des 4 mains de la région wallonne, se sont associées pour cette production, dont l’action est située dans la troisième région, Bruxelles-Capitale bilingue.
Le résultat est clair : quand deux cultures se rencontrent ainsi dans la créativité, au lieu de donner lieu à une stérile lutte pour prédominer elles se nourrissent, se fécondent. L’imagination, l’adresse et l’humour entrent en ligne de compte, et les gens peuvent rire des autres, d’eux-mêmes et tous ensemble.
_________________________________________________________________________________
Les derniers rites
Une vieille femme au dos voûté, le visage déformé par l’âge, s’affaire dans son logement obscur, à peine éclairé par de petites lampes de table qu’elle n’arrête pas de mettre et d’éteindre. En silence, elle répare ses lunettes avec un morceau de bande de masquage.
Elle se lève, regarde de près le public du Petit Bouffon, retourne à ses occupations. Ce regard soutenu n’est pas curieux, ne cherche pas le contact ; c’est plus une dernière prise de conscience de son appartenance à l’humanité. La vieille dame se prépare à partir.
C’est le début de Go !, écrit, mis en scène et joué en « marionnette habitée » par Polina Borisova, marionnettiste d’origine et de formation russe.
La vieille prendra son départ devant ceux qui la regardent. Elle n’est pas triste, exécute même de petits pas de danse de temps en temps, guillerette, apparemment soulagée de s’approcher de la fin. Elle ne dit pas un mot.
Avec d’infinies précautions elle verse des granulés dans le bol du chat resté invisible. Elle amène une boîte et en sort des papiers, une lettre, une médaille. La musique de fond laisse entendre qu’il s’agirait d’articles datant de l’époque soviétique. Qu’en fera-t-elle ?
C’est là que le spectacle cesse d’être une étude naturaliste de la vieillesse et la fin de vie, et prend son envol théâtral et imaginatif. La réparation des lunettes du début en était un signe avant-coureur.
La vieille dame prend son rouleau de bande de masquage, en colle un bout en courbe sur le rideau de fond de scène, puis deux longueurs droites. Petit à petit il émerge la forme d’un poêle, avec une petite porte. Elle prend ses souvenirs, les entoure de bande pour faire un paquet, l’approche de la porte de poêle et le colle en place. Elle ajoute un tuyau et de la fumée qui en échappe. Elle a brûlé les objets et papiers.
Elle revient ainsi sur sa vie, ses souvenirs, l’homme qu’elle a aimé. Chaque épisode est illustré par des images sur le rideau. L’effet est éloquent : qu’une bande adhésive puisse être si éloquente est un vrai coup de théâtre.
Le vieille dame dessine une porte, avec trois longueurs de bande. Elle vide la boîte de granulés, qui débordent du bol, tombent par terre. C’est son dernier geste. Elle va à la porte, ajoute deux morceaux de bande pour en faire une porte entrouverte, et fait un pas. La scène est plongée dans l’obscurité. Elle est partie, littéralement et selon l’euphémisme utilisé pour parler de la mort.
L’éclairage revient, et voilà, son masque enlevé et son corps redressé, une jeune femme rayonnante. Elle propose de répondre aux questions. Les spectateurs n’en posent aucune, comme pour ne pas interrompre l’expérience qu’ils ont vécue.
Interrogée le lendemain tard sur le titre, Polina Borisova précise c’est simplement le mot anglais, qu’elle interprète comme « On y va ! » « Vas-y » ou « Départ ! ». Elle explique : « J’aime l’idée que ce que l’on croit la fin d’un voyage, le long voyage qui est la vie, n’est qu’un départ, une libération en quelque sorte. »
Polina Borisova a crée un spectacle d’une grande profondeur sur la fin de vie, avec une époustouflante économie de moyens. Avec sa bande de masquage elle fait rire et émeut.
_________________________________________________________________________________
Curriculum vitae
Les cinéphiles dans la salle Prestige de Cuffies qui connaissaient déjà Riton Liebman pour avoir vu son jeune visage doux entouré de longs cheveux dans Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier ont dû s’ajuster à la vue de l’homme de 54 ans sur scène. Trapu, fort, même un peu trop au ventre (qu’il a exhibé en se changeant), il laisse voir l’usure du temps sur le corps et le visage. Belge et juif, il raconte, dans La vedette du quartier, son aventure enfantine, qui a fait de lui une célébrité dans son quartier de Bruxelles. On le harcelait de questions : « Gérard Depardieu et Patrick Dewaere, comment ils sont ? » ou, vu sa scène avec Carole Laure nue, « Est-ce que tu as… ? »
Un beau début, suivi, il le dit avec franchise, d’une carrière sans autre sommet, des écueils, des écarts, des esclandres, « vingt-cinq ans de psychanalyse à raison de neuf séances par semaine » (il est quand-même humoriste).
Riton se raconte avec un humour parfois féroce, souvent railleur, rejoue les incidents marquants de sa vie, danse, imite le Johnny national français né en Belgique. Soudain, au milieu d’une anecdote sur une sortie au restaurant avec Claudia Cardinale, il s’arrête, découragé, s’adresse aux spectateurs pour demander si cela vaut la peine de continuer. L’abîme sous les pieds du comédien est visible.
En conclusion, il résume en annonçant « Ca va. » Oui, ça va. Il a trouvé un équilibre, à se réconcilier avec lui-même.
Il reste pourtant une chose qu’il n’accepte pas, admet-il pour conclure. Quel comportement honteux ou inacceptable, quelle rancune ou agressivité ? Il s’agit plutôt d’un mauvais coup du destin, que n’adoucit pas le fait d’être largement partagé, surtout parmi les hommes. Il se tourne, et pointe du doigt… le début de calvitie au sommet de la tête. Revenant recevoir les applaudissements, il couvre le trou dans sa chevelure avec une main.
Au début du spectacle il était arrivé si discrètement sur scène qu’on pouvait facilement le prendre pour un technicien venu vérifier un dernier détail d’éclairage. Puis il s’était adressé au public, engageant une conversation presque timide, qui est devenue ce récit d’une vie, dit avec une dose d’autodérision.
« J’ai pleuré » dit un spectateur en sortant sur le parvis.
_________________________________________________________________________________
De Beckett à Kafka
VO sait trouver des spectacles de cirque/d’acrobates (« arts du mime et du geste » dit le programme VO) dans lesquels les prouesses physiques s’accompagnent d’une réflexion, une évocation de la complexité humaine qui sous-tend le corps. Notamment, il y a eu Quien soy ? en 2015, avec deux acrobates dont l’aîné guidait, encourageait et retenait le plus jeune.
Encore une heure si courte commence comme une pièce de Beckett, trois hommes émergeant de boîtes dans lesquelles ils ont dû être comprimés comme un diable à ressort. L’absurdité est dans l’air.
Le milieu qui les attend les mystifie. Ils cherchent, à l’aide d’un plan, à s’y retrouver. Peu à peu, l’inquiétude et la frustration les envahissent. Ils parlent de temps en temps, mais dans une langue étrange qu’ils ne semblent pas comprendre eux-mêmes. Leurs exploits acrobatiques n’y font rien.
Pour finir, ils vident des boîtes de papiers, alors que des paquets tombent des cintres. Le plateau en est recouvert, comme si le plan qui devait les guider s’était multiplié. Comment trouver le chemin ? Comment reconnaître quelque chose ? Où sont-ils, où vont-ils ? Kafka n’est pas loin.
_________________________________________________________________________________
Scènes de ménage
Si le théâtre est un projecteur dirigé sur les comportements humains, alors Moi je crois pas ! remplit bien sa fonction. Une série de saynètes examine le dernier stade d’une relation conjugale, en reprenant, chaque fois d’un autre angle, le désaccord fondamental qui divise un couple, tout en rehaussant les paroles et l’action pour éviter un plat naturalisme.
Cécile Soudé et Jean Boulanger ont mis en scène et jouent les deux rôles de la pièce de Jean-Claude Grumberg. Un couple, marié depuis longtemps – trop, penseraient certains – ne change pas sa routine du soir. Lui rentre du travail, elle l’attend sans l’accueillir ; lui annonce tout de go ce à quoi il ne croit pas, comme l’existence des yetis ou la vie après la mort. Sa femme prend chaque fois le contrepied, soit directement (et les empreintes de pieds géants dans la neige ?) ou indirectement (au contraire, c’est avant la mort qu’il n’y a pas de vie). C’est un rituel : lui s’énerve, s’emporte, s’agite ; elle s’énerve, reste implacable et assise. Quand l’affrontement a duré le temps qu’il leur faut pour arriver à l’impasse, il demande soit ce qu’il y a à la télé, soit ce qu’ils bouffent ce soir.
Jean Boulanger est tout en gesticulations, Cécile Soudé est toute serrée.
L’enfer domestique ? Alors pourquoi ils ne se quittent pas ? Ce couple a trouvé un vocabulaire pour maintenir la relation sans laquelle chacun serait seul. La pièce traite de ce qui suit le déclin de l’amour romantique et de la bienveillance quotidienne qui en fait partie. Il reste l’engagement mutuel. Tout en se battant par argument interposé, ils le respectent. En retour, les querelles les maintiennent en forme. L’apathie est loin.
L’humour sature la pièce, et le public rit, même de bon cœur, devant le combat de catch marital sur scène.
Seul le dénouement est frustrant. Dans la dernière saynète l’homme a perdu la tête, reste immobile, ne peut plus articuler. La pièce aurait pu se conclure en les laissant tous les deux poursuivre fidèlement leurs confrontations.
_________________________________________________________________________________
La fièvre du samedi soir
Des échos reviennent encore de la folle soirée Zazuza.
« Un très bon groupe. » « Tout le monde participait. » « Moi et ***, alors que cela faisait une éternité que nous n’avions pas dansé ensemble, nous voilà sur la piste. » Le Madison semble avoir particulièrement plu.
La petite salle du Mail, redevenue spectaculairement salle des fêtes, a hébergé tous les guincheurs, spectateurs soudain sur scène. La soirée, une innovation pour VO en Soissonnais, montre son ouverture sur de nouvelles formes de spectacle.
_________________________________________________________________________________
Un numéro sur le dos
Absent de Welcome à Bienvenue, du chorégraphe Xavier Lot et du danseur Bienvenue Bazié, j’ai demandé à Martine Besset de faire part de sa réaction :
La scène est à peine éclairée par une douzaine de lumignons ; pendant de longues minutes, on ne distingue, sous la lueur de l’un d’eux, qu’un dos : un dos imprimé de lettres et de chiffres blancs, un numéro de visa si l’on en croit le programme. Au rythme lent d’une musique lancinante, les muscles jouent sous la peau brune et les signes blancs. Puis la scène s’éclaire, la musique enfle, et le dos se rassemble avec un corps qui danse.
Bienvenue a un corps d’athlète, la grâce d’un chat, et une technique époustouflante qui n’altère jamais l’émotion.
Je n’ai pas tout compris, et les quelques paroles psalmodiées dans une langue inconnue ne m’ont pas éclairée…Mais c’était très beau !
_______________________________________________________________________________
Les mains dans la terre
Alicia Le Breton a-t-elle fait de longues études de psychologie enfantine avant de concevoir son spectacle La gadoue ? Elle rit. « Plutôt d’histoire. Mais ma mère était institutrice et j’ai beaucoup appris d’elle. Puis j’ai observé. » Elle a déjà fait deux autres spectacles sur les éléments : l’eau et l’air.
Comme j’ai déjà fait lors de spectacles pour petits enfants, je me suis fait accompagner par un spectateur dans la fourchette d’âge concernée. Maya a tout juste deux ans, et c’était sa deuxième sortie au théâtre.
A partir d’un gâteau en faux chocolat, la comédienne entre par petites touches dans le monde de la transgression. Elle en prend sur les doigts, l’étale sur les deux mains, et laisse l’empreinte de ses mains sur toutes les surfaces et même – l’osée ! – sur son tablier.
Tout est subtile dans son jeu. Il s’agit d’accepter les maladresses des enfants qui jouent avec des matières salissantes, mais elle ne fait pas n’importe quoi : ses gestes sont précis, et son application de gadoue est créative, faisant penser aux dessins préhistoriques dans les grottes du Périgord.
La manieuse de gadoue est étonnée et enchantée par ce qui se passe, et maintient toujours un contact souriant avec ses spectateurs. Ses actions sont accompagnées d’une jolie musique et un petit chant sur « la gadoue » où j’ai crû entendre, cachés dans la ritournelle, le mot « caca ». Mais je devrais peut-être me laver les oreilles, comme on faisait se laver la bouche aux enfants proférant de gros mots à l’école.
Pour finir elle s’essuie, et se lave les mains, les genoux et les pieds. L’ordre est rétabli après ces dérives boueuses. Ensuite, elle invite l’assistance à venir toucher à la gadoue qui recouvre une partie de la scène. Ils viennent, mais sont très précautionneux : les parents sont derrière.
Ma critique adjointe ? Elle avait eu un moment de flottement, d’incompréhension au tout début, puis a regardé attentivement. Elle a même fait une interjection lorsque la taupe dans la boîte, qui avait déjà envoyé des jets de terre en l’air, a sorti sa tête et une patte. En rentrant à la maison je l’ai sollicitée. Je voulais son exégèse du spectacle… Mais elle était déjà passée à autre chose.
_________________________________________________________________________________
Mille et un ans c’est long ?
Le texte de Quand j’aurai mille et un ans ayant été retrouvé un extremis (voir Un grand éclat de théâtre pour commencer ci-dessous), la compagnie des Lucioles, venue en voisin de Compiègne et familière du Mail (dernièrement avec Qui rira verra), a pu faire entrer les centaines de jeunes scolaires dans la grande salle du Mail dans le mystère de l’âge, de la durée de vie des humains, voire de l’immortalité.
Le propre de Jérôme Wacquiez, directeur des Lucioles, est de travailler avec un auteur, dans ce cas Nathalie Papin, auteure de Qui rira verra. Elle déclare être entrée dans une nouvelle étape d’écriture. Au lieu de partir de l’imaginaire, elle veut prendre pour base le réel.
Parlant de cette nouvelle pièce elle a écrit : « J’ai demandé à des enfants s’ils aimeraient avoir, à côté d’eux, une personne de leur âge d’une autre époque. Et un enfant m’a dit : « Moi, j’aimerais être à côté d’un enfant du futur… ». Et voila, c’est parti de cette phrase simple. Qu’est-ce que c’est un enfant du futur, comment peut-on se le représenter ? Une jeune femme m’a dit aussi : « De toute façon, l’enfant qui aura mille ans est déjà né… »
Cendi, s’échappant d’une guerre un vieux bateau, se sauve du naufrage parce elle sait retenir son souffle pendant vingt-deux minutes – et se trouve dans un étrange couloir sous-marin. Elle qui a onze ans et qui rêve d’atteindre 117 ans y rencontre un garçon qui doit vivre mille et un ans, et une femme déjà âgé de 125 ans. A la fin, elle prend un grand souffle, quitte le sous-marin et nage vers la surface de la mer.
Dans une scénographie de Benoît Szymanski à la fois éloquente et symbolique, faite de cerceaux formant quelque chose comme une station de Métro, avec des images de l’océan et ses extraordinaires créatures projetées au fond, trois comédiens-danseurs portent l’histoire et ses réflexions. Basile Yawanké bondit avec l’énergie qu’il faudra à son personnage pour arriver à son mille-et-unième anniversaire. Makiko Kawai, au visage à la japonaise et dont la longue chevelure blanche (une perruque, peut-on penser) devient presque un quatrième personnage, ne dit pas un mot, mais émet des sons chantés et, comme si elle vivait simultanément les différents âges de ses 125 ans, alterne une vieille femme au dos voûté et à la démarche difficile et une naïade dansante.
Il est notoirement difficile pour un adulte de jouer un enfant, de montrer la franchise énergie et la naïveté sans tomber dans les facilités de l’espièglerie et des gestes saccadés. Alice Benoit (un des inspecteurs de la chasse au livret de la veille) s’en sort honnêtement. Elle a bien observé les comportements enfantins ; ses propres sensations pourraient encore l’enrichir.
__________________________________________________________________________
Un grand éclat de théâtre pour commencer
VO en Soissonnais pouvait difficilement démontrer avec plus de certitude son ambition de former le futur public de théâtre qu’avec Valises et versa, production collective de la compagnie des Lucioles. Le premier jour du festival a même été réservé au public écolier, plus précisément les élèves de l’école Raymonde-Fiolet, avec cinq séances sur deux jours.
Deux inspecteurs un peu bizarres de la PJ, sous les traits élastiques d’Alice Benoit et Nicolas Chevrier, arrivent devant le public dans l’espace polyvalent de l’école, pour enquêter sur la disparition du texte de la pièce de Nathalie Papin Quand j’aurai mille et un ans (qui sera jouée le lendemain au Mail, dans une belle mise en abyme).
Devant un tas de vieilles valises délabrées par une vie de voyages, ces inspecteurs demandent l’aide des spectateurs pour ce qui devient une chasse au trésor, avec indices, cartes et codes secrets à deviner.
Chaque valise qu’ils ouvrent révèle une nouvelle étape de la quête, jusqu’à la dernière, qui contient le livret de la pièce – et un sac de bonbons, que ces vilains inspecteurs essaient de cacher sous leur pardessus de détectives, avant d’avoir honte et de les distribuer aux spectateurs, jeunes, instituteurs/rices, la bénévole de service de VO… et la presse !
Chaque valise contient des objets étonnants, une couronne, des pots de confiture, un cercueil avec un squelette. Chaque fois, l’enquête avance.
Deux comédiens, donc, mais qui pratiquent le théâtre participatif au point que les élèves dans la salle deviennent une partie de la distribution. C’est un grand éclat de théâtre : les acteurs encouragent la participation jusqu’à déclencher des explosions de cris. L’énergie est enthousiasmante, pour les jeunes et les adultes présents. Ce qui est admirable est la capacité des acteurs à gérer – sans jamais brider – ces éclats, et de ramener les spectateurs à leur rôle d’apprentis policiers.
__________________________________________________________________________
En cinq jours d’intensité théâtrale, le festival annuel de théâtre VO en Soissonnais présentera douze spectacles, dont un qui est prévu pour le jeune public à partir de un an, et deux réservés aux élèves du primaire. En plein milieu il y a même le bal endiablé du samedi soir, où les spectateurs occuperont la piste de danse et deviendront eux-mêmes le spectacle.
Ceux qui connaissent VO savent combien grisante est la compression en si peu de temps de tant de formes théâtrales. Mais au lieu de ne plus savoir où on en est, le spectateur attentif et sensible commence à construire un panorama, dans lequel chaque événement reste distinct, mais éclaire les autres, et en est éclairé.
Pendant le festival, le Vase des Arts entend suivre le programme au jour le jour, comme c’est devenu son habitude. La chronique sera un panorama personnel. Elle sera mise à jour de spectacle en spectacle. Il s’agit d’une réaction plus qu’un jugement, une tentative, comme le terme l’indique, de traduire l’éclairage de VO en Soissonnais.
Les réactions, commentaires et contestations des lecteurs du Vase des Arts ne pourraient qu’enrichir son contenu.
denis.mahaffey@levase.fr
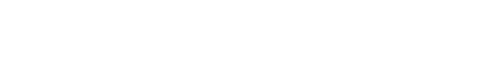










 et y accéder depuis
et y accéder depuis